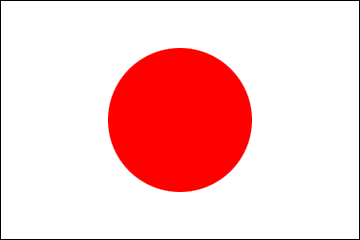Newsletter mensuelle (Edition de septembre 2024)
2024/9/6
【Newsletter Mensuelle de l’Ambassade du Japon, édition d’août publiée le 6 septembre 2024】
◆ Table des matières ◆
1 Message de l’Ambassadeur IZAWA Osamu
2 Contribution
3 Avis de Recrutement
4 Activités de l’Ambassade
***********************
1 Message de l’Ambassadeur IZAWA Osamu
Le mois d'août est caractérisé par des nuages et des averses occasionnelles semblables à des grains, mais la pluie ne dure pas des jours entiers comme pendant la saison des pluies, et les inondations dans la ville ne sont heureusement pas aussi graves que celles qui ont eu lieu il y a deux ans. La chaleur n'est pas aussi forte qu'à Tokyo. Comment tout le monde se porte-t-il ?
Comme nous l'avons mentionné dans le message d'accueil du numéro d'octobre dernier, il reste de nombreuses mines terrestres dans la région de Casamance, ce qui entrave la reconstruction de la région. Le gouvernement japonais a décidé de promouvoir activement la coopération pour le déminage et, en juillet, j'ai signé une lettre d'échange pour une aide non remboursable afin de fournir deux bulldozers spéciaux et d'autres équipements et matériels pour le déminage. Une société japonaise développe ces bulldozers spéciaux et cette technologie japonaise sera utile pour le déminage dans la région de Casamance. Parallèlement, en août, une ONG appelée JMAS, dirigée par d'anciens membres des forces d'autodéfense, s'est rendue dans la région de Casamance pour étudier la possibilité d'une coopération en matière de déminage par des officiers retraités des forces terrestres d'autodéfense (GSDF). Ainsi, le Japon coopérera pleinement au déminage, à la fois en termes de coopération humaine et matérielle.
Depuis la seconde moitié du mois d'août, des étudiants de l'université de Kyoto Seïka se sont rendus dans certaines régions pour des travaux sur le terrain. Ce voyage de recherche au Sénégal a commencé il y a deux ans et les étudiants viennent chaque été, et c'est la troisième fois que je les accueille. L'université Seïka de Kyoto a été la première université japonaise à créer un département d'animation, et l'ancien président de l'université Seïka, Sako, m'a donné des conseils sur la manière de promouvoir les échanges au Sénégal par le biais de mangas et d'animes japonais. Bien que peu connue au Japon, l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal, est une région intéressante à étudier en raison de ses caractéristiques sociales et culturelles, telles que la langue, la religion et les coutumes sociales. Comme pour la visite des étudiants cette fois-ci, nous les accueillons avec l'espoir que le nombre de chercheurs et de Japonais qui s'intéressent à cette région de l'Afrique de l'Ouest augmentera.
Depuis le 4 septembre, Mme Noriko Furuya, épouse de l'ancien ambassadeur Furuya du Japon au Sénégal et représentante de l'association « Lavons les mains », est en visite au Sénégal. C'est la première fois depuis longtemps que Mme Noriko Furuya revient au Sénégal et cette fois, dans le cadre des activités de l'association « Lavons-nous les mains », elle a apporté un livre d'images intitulé « Digante » écrit en japonais, en français et en wolof pour les enfants sénégalais, créé par sa petite-fille, Midori. En tant que Japonaise, il semble naturel que les enfants reçoivent un enseignement scolaire dans leur langue maternelle, le japonais, mais au Sénégal, des discussions sont en cours sur la manière d'utiliser le wolof et le français, les langues de nombreux Sénégalais, dans l'enseignement scolaire. Mme Noriko Furuya pense que l'éducation dans la langue maternelle est importante, et elle a créé ce livre d'images avec Midori-san.
À propos de langue, Mirei Tomoyama, étudiante en troisième année à l'université de Keio, s'est récemment rendue au Sénégal. Elle pense que les enfants sénégalais doivent comprendre le français pour recevoir une bonne éducation et travaille sur une application permettant aux enfants d'apprendre le français à partir du wolof. Je suis vraiment impressionné par le fait qu'une jeune étudiante se lance encore dans ce genre d'entreprise. Tout en repensant à mes propres années d'études dans un passé lointain, lorsque je m'amusais, j'encourage les jeunes du Japon d'aujourd'hui, en pensant qu'ils s'en sortent plutôt bien.
Enfin, au début du mois de septembre, Sachiko Nakajima, l'un des producteurs de l'exposition d'Osaka de l'année prochaine et leader du « Kurage Band », est venu au Sénégal avec le groupe et une équipe de tournage de Yomiuri TV. Ils se sont rendus sur place pour filmer des séquences qui seront présentées au « pavillon des méduses » de l'exposition. Le tournage a eu lieu sur l'île de Gorée, dans la ville de Dakar et à Nbour, en particulier sur l'île de Gorée, où le Kurage Band s'est produit avec la famille Ndiaye Rose. La pianiste Mme Nakajima a joué avec plaisir le piano, qui a été donné lors du festival de musique de paix de l'île de Gorée en juin et qui est maintenant entreposé dans le centre culturel de la ville de Gorée. Au cours de la visite et de la représentation, Mme Nakajima a été ravie d'être submergée par l'atmosphère sénégalaise. Le thème du pavillon des méduses est « Améliorer la vie ». Nous attendons avec impatience de voir quelles images du Sénégal seront présentées à l'Expo l'année prochaine.
2 Contribution – KIMIJIMA Takashi, Expert de la JICA dans le domaine de l’agriculture, Président et Directeur Représentant de RECS International Inc.
1. Introduction
Je suis consultant en développement et j'ai 40 ans d'expérience dans le domaine de l'aide publique au développement (APD), y compris la recherche, la planification et le transfert de technologie liés au développement agricole et rural et au développement régional dans les pays en développement du monde entier. Au cours des 20 dernières années, je me suis spécialisé dans la coopération technique pour la promotion de la production de riz en Afrique, en me concentrant sur deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Sierra Leone. Dans cet article, je vous raconterai l'histoire de mon travail et de la riziculture au Sénégal, domaine dans lequel j'ai une longue expérience.
2. L'étude du schéma directeur et le riz qui m'ont amené à intervenir au Sénégal
Ma relation avec le Sénégal a commencé en 2004, il y a 20 ans. J'ai été approché par un consultant qui était un étudiant senior et qui participait à un projet d'enquête de la JICA. L'objectif de l'enquête était d'identifier la situation actuelle et les défis du secteur du riz et de préparer un plan directeur pour le développement du secteur au cours des 10 prochaines années. L'étude a duré environ deux ans et a impliqué huit experts japonais, y compris moi-même et j'étais chargé de la technologie de la riziculture et des aspects socio-économiques.
À l'époque, le secteur rizicole sénégalais était en pleine tourmente suite à la politique d'ajustement structurel de la Banque mondiale, qui comprenait la dévaluation de la monnaie en 1994 et le démantèlement des entreprises d'État qui soutenaient tout, de la production à la transformation et à la distribution. Le prix des machines et des engrais importés a doublé à la suite de la dévaluation de la monnaie, ce qui a entraîné une hausse considérable des coûts de production. Parallèlement, le démantèlement des entreprises d'État a coupé les canaux de distribution, laissant les producteurs sans endroit où vendre leur riz, même s'ils le produisent. En particulier, pour les organisations paysannes qui vivaient de la culture du riz dans le bassin du fleuve Sénégal, où des installations d'irrigation avaient été développées, l'impossibilité de vendre le riz qu'elles produisaient était une question de vitale. On dit que ce projet de recherche a été créé par le chef du bureau de la JICA au Sénégal de l'époque, qui a entendu les voix sérieuses des riziculteurs sur le terrain : « Nous voulons que vous puissiez vendre le riz que vous produisez ».
3. L'impact du schéma directeur et la contribution du Japon à la filière rizicole sénégalaise
suite à l'étude du plan directeur
Il est apparu clairement que la question la plus importante pour rendre le riz sénégalais vendable, ainsi que pour sécuriser les canaux de distribution était d'améliorer la qualité du riz usiné afin de répondre aux préférences des consommateurs. Les consommateurs urbains de Dakar et d'ailleurs évitent le riz produit localement, de couleur terne et contaminé par des impuretés, y compris des cailloux, au profit du riz importé. Ce n'est qu'en améliorant la qualité de l'usinage que les riziculteurs pourront produire du riz en toute sérénité. Le plan a défini les priorités et l'orientation du développement futur de la riziculture. Par la suite, sur la base des résultats de ce plan directeur, la JICA a mis en œuvre une coopération technique visant à améliorer la productivité du riz dans les zones irriguées du nord du bassin du fleuve Sénégal, qui dispose d'un potentiel de production élevé, et a introduit des machines japonaises d'usinage et de triage du riz auprès des riziculteurs, ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité d'usinage du riz produit dans le pays. En conséquence, le riz produit dans le bassin du fleuve Sénégal (riz produit localement) est maintenant disponible pour la première fois dans les supermarchés de la capitale Dakar.
Il s'agit d'une contribution très importante du Japon à la réalisation du plan d'autosuffisance en riz, qui est également la politique nationale du Sénégal. Les agriculteurs sont maintenant en mesure de se concentrer sur la production, car ils se rendent compte que le riz produit localement se vend bien.
4. La diversité de la riziculture au Sénégal
D'autre part, cette étude a révélé que l'environnement de la production rizicole au Sénégal varie considérablement d'une région à l'autre en termes de conditions naturelles, de contexte socioculturel et de riziculteurs. Certains de ces éléments sont présentés ci-dessous.
Les zones de production rizicole se répartissent principalement entre le bassin du fleuve Sénégal au nord, le bassin du fleuve Sine Saloum au centre, le bassin du fleuve Gambie au sud-est et la région de Casamance au sud.
Le bassin du fleuve Sénégal est proche de la limite méridionale du désert du Sahara, avec des précipitations de l'ordre de 200-400 mm/an, et l'agriculture est principalement pratiquée dans un environnement hydrique contrôlé, avec des installations d'irrigation construites le long du fleuve Sénégal avec l'aide de donateurs. La région dispose d'une distribution de sols argileux propices à la croissance du riz et d'un rayonnement solaire très élevé, ce qui permet une riziculture très productive avec des intrants importants. L'histoire de la riziculture est relativement récente et la culture du riz est pratiquée principalement par les Wolofs dans le cours inférieur du fleuve, mais au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les terres, la plupart des habitants sont des Peuls, qui étaient à l'origine des nomades.
Dans le bassin du fleuve Sine Saloum, dans la partie centrale, et dans le bassin du fleuve Gambie, dans le sud-est, l'agriculture est essentiellement pratiquée dans les champs. En raison des faibles précipitations, l'aliment de base est principalement le mil et le maïs produits par les hommes. La culture du riz, qui est pratiquée à petite échelle dans des zones de plaine limitées, est principalement destinée à la subsistance, les femmes étant chargées de tout, du labour à la récolte et à la manutention post-récolte. Les femmes, dont le statut religieux et socioculturel est inférieur à celui des hommes, ont un accès limité à l'information et à la technologie, ont hérité des méthodes agricoles traditionnelles de leurs parents et effectuent presque tous les travaux agricoles à la main. Elles s'occupent également des tâches ménagères et des enfants, et travaillent sans dormir. La culture du riz aurait été introduite par des migrants venus de la Gambie voisine, au sud, ou de la Casamance, plus au sud.
En revanche, dans le sud de la région de Casamance, les méthodes de culture du riz diffèrent selon l'ethnie qui habite la région, et à Ziguinchor, qui serait la plus ancienne zone de culture du riz, la culture du riz par les Jolas est solidement établie. Le labour est effectué par les hommes à l'aide d'une houe spéciale à long manche, appelée kajandu, qui a la forme d'une rame de bateau. Les femmes créent ensuite une pépinière, cultivent les jeunes plants et les transplantent dans les zones labourées et billonnées par les hommes. Les mauvaises herbes poussent rarement dans cette région et le désherbage est donc rare. La récolte se fait en coupant la base de l'épi à l'aide d'un couteau, en regroupant les épis coupés et en les portant sur la tête. Pour eux, le riz est utilisé comme une offrande sacrée, pour les mariages et les funérailles, ce qui explique probablement pourquoi certaines régions n'utilisent toujours pas de produits chimiques ou de machines pour la culture du riz. Ils disent également que lorsque le chef de famille meurt, sa grandeur est indiquée par la quantité de riz stockée dans la maison. En outre, on raconte qu'il existe une réserve constante de riz pour aider ceux qui ont besoin de nourriture.
Il existe donc une grande variété de cultures de riz au Sénégal !
5. Ma méthode de transfert de technologie
Depuis l'étude du plan directeur susmentionné, j'ai eu la chance de participer à quatre projets de coopération technique au Sénégal liés à la promotion du riz, en travaillant avec des agriculteurs et leurs agents de vulgarisation dans le nord, le centre et le sud-est du pays pour développer et diffuser des technologies permettant d'améliorer la productivité du riz dans le passé, j'ai travaillé avec des agriculteurs et leurs agents de vulgarisation pour développer et diffuser des technologies visant à améliorer la productivité du riz. Le développement d'une technologie n'est pas une tâche difficile, mais plutôt une application opportune de la technologie en fonction de la saison de croissance de la plante de riz afin de rendre les pratiques agricoles des agriculteurs plus efficaces et efficientes.
Bien que j'en sache plus qu'eux sur le riz, les agriculteurs locaux maitrisent bien l'environnement local, comme le climat et la nature du sol. Même si, à première vue, cela peut sembler inapproprié, il y a une certaine rationalité dans leurs pratiques agricoles, et si nous imposons seulement notre théorie sans la comprendre, elle ne sera pas acceptée et échouera. Il faut d'abord connaître la riziculture qu'ils pratiquent et l'environnement de la riziculture, puis trier les problèmes, réfléchir à différentes approches pour les résoudre et les expliquer aux agriculteurs par un processus d'essais et d'erreurs. Il faut parfois du temps pour obtenir des résultats, mais nous procédons ainsi parce que nous pensons qu'il s'agit de la méthode la plus fiable. Ce processus permet également d'instaurer un climat de confiance avec les agriculteurs.
6. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui se passera à l'avenir ?
Les projets de coopération technique auxquels nous avons participé dans le nord et le centre du pays ont confirmé l'efficacité des technologies recommandées que nous avons développées, et les riziculteurs auxquels ces technologies ont été transférées ont considérablement augmenté leur productivité.
Actuellement, dans le sud-est, nous relevons le défi d'améliorer la productivité du riz pluvial dans des environnements divers, où l'environnement naturel et les riziculteurs sont différents. Une liste de mots-clés pour les défis révèle qu'ils sont nombreux : la bonne variété, la culture du riz pluvial, la gestion des mauvaises herbes, les herbicides, la bonne quantité de semis, la gestion de l'eau, la conservation des sols, les machines agricoles appropriées, le genre, etc. Chacun de ces problèmes n'est pas facile à résoudre, mais nous parcourons avec eux les parcelles de riz des agriculteurs coopérants et des groupes d'agriculteurs, nous observons la croissance du riz et nous échangeons avec eux des points de vue sur les pratiques et les techniques agricoles que nous avons essayées.
À l'avenir, parallèlement à notre travail actuel dans le sud-est, nous prévoyons également de soutenir la riziculture dans le sud de la région de Casamance, qui est considérée comme la plus ancienne région rizicole du Sénégal. Après avoir commencé par la riziculture irriguée dans le nord, nous avons finalement atteint, après 20 ans, la riziculture pluviale dans le sud, la terre sacrée du riz sénégalais.
Dans le cadre de mon travail, j’ai côtoyé la vie et la culture des sénégalais et j'ai été touché par leur gentillesse, leur gaieté et leur générosité. Un ami sénégalais m'a dit un jour : « You Island, vieillir n'est pas une question d'âge, mais d'état d'esprit », et cela m'est apparu clairement vrai. J'ai maintenant l'âge de prendre ma retraite à tout moment, mais je veux garder l'esprit jeune et continuer à faire ce que je peux pour le Sénégal un peu plus longtemps.
3 Avis de Recrutement
L’Ambassade du Japon au Sénégal cherche un Secrétaire (à temps plein)pour sa Section Protocole, Affaires Politiques et Générales.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/files/100713433.pdf
4 Activités et annonces de l’Ambassade du Japon
○Réunion ministérielle sur la TICAD 9
La réunion ministérielle sur la TICAD 9 s’est tenue les 24 et 25 août à Tokyo. S.E. Mme Yacine FALL, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal y a pris part.
https://www.mofa.go.jp/af/af1/pagewe_000001_00054.html
https://x.com/MiaaeSenegal/status/1827749666622156927
○Visite de courtoisie auprès de S.E.Mme. DIOUF, Ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires
Le 29 août, l'Ambassadeur Izawa a rendu une visite de courtoisie au ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Mme. Fatou DIOUF, et a échangé des points de vue sur la coopération économique dans le secteur de la pêche.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01512.html
○Visite de courtoisie auprès de S.E.M. DIOP, Ministre de l'Industrie et du Commerce
Le 29 août, l'Ambassadeur Izawa a rendu visite au Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. DIOP, et ils ont échangé sur les stratégies de l'industrialisation du Sénégal ainsi que sur la participation du Sénégal à l'Expo 2025 prévue l'année prochaine.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01510.html
○Réception avec l’équipe de l’Université Koto Seïka
Le 26 août, l’Ambassadeur Izawa a accueilli l’équipe de l’université Kyoto Seïka à sa résidence, et discuté sur l’échange interuniversitaire entre le Japon et le Sénégal.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LAXGca8kcuVkx3GMPTe1aKJd5M4Hn94uU6kTRvxiMWbdK1zZiG8DvgQMzwiTP584l&id=100078921276471
----------------------------------------------------------------------
○Liens de l’Ambassade du Japon
Site web( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
Twitter ( https://twitter.com/JapanEmbSenegal )
Facebook ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471 )
Instagram ( https://www.instagram.com/japanembsenegal/ )
○Publication:Ambassade du Japon au Sénégal
Ambassade du Japon au Sénégal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Sénégal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55
◆ Table des matières ◆
1 Message de l’Ambassadeur IZAWA Osamu
2 Contribution
3 Avis de Recrutement
4 Activités de l’Ambassade
***********************
1 Message de l’Ambassadeur IZAWA Osamu
Le mois d'août est caractérisé par des nuages et des averses occasionnelles semblables à des grains, mais la pluie ne dure pas des jours entiers comme pendant la saison des pluies, et les inondations dans la ville ne sont heureusement pas aussi graves que celles qui ont eu lieu il y a deux ans. La chaleur n'est pas aussi forte qu'à Tokyo. Comment tout le monde se porte-t-il ?
Comme nous l'avons mentionné dans le message d'accueil du numéro d'octobre dernier, il reste de nombreuses mines terrestres dans la région de Casamance, ce qui entrave la reconstruction de la région. Le gouvernement japonais a décidé de promouvoir activement la coopération pour le déminage et, en juillet, j'ai signé une lettre d'échange pour une aide non remboursable afin de fournir deux bulldozers spéciaux et d'autres équipements et matériels pour le déminage. Une société japonaise développe ces bulldozers spéciaux et cette technologie japonaise sera utile pour le déminage dans la région de Casamance. Parallèlement, en août, une ONG appelée JMAS, dirigée par d'anciens membres des forces d'autodéfense, s'est rendue dans la région de Casamance pour étudier la possibilité d'une coopération en matière de déminage par des officiers retraités des forces terrestres d'autodéfense (GSDF). Ainsi, le Japon coopérera pleinement au déminage, à la fois en termes de coopération humaine et matérielle.
Depuis la seconde moitié du mois d'août, des étudiants de l'université de Kyoto Seïka se sont rendus dans certaines régions pour des travaux sur le terrain. Ce voyage de recherche au Sénégal a commencé il y a deux ans et les étudiants viennent chaque été, et c'est la troisième fois que je les accueille. L'université Seïka de Kyoto a été la première université japonaise à créer un département d'animation, et l'ancien président de l'université Seïka, Sako, m'a donné des conseils sur la manière de promouvoir les échanges au Sénégal par le biais de mangas et d'animes japonais. Bien que peu connue au Japon, l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal, est une région intéressante à étudier en raison de ses caractéristiques sociales et culturelles, telles que la langue, la religion et les coutumes sociales. Comme pour la visite des étudiants cette fois-ci, nous les accueillons avec l'espoir que le nombre de chercheurs et de Japonais qui s'intéressent à cette région de l'Afrique de l'Ouest augmentera.
Depuis le 4 septembre, Mme Noriko Furuya, épouse de l'ancien ambassadeur Furuya du Japon au Sénégal et représentante de l'association « Lavons les mains », est en visite au Sénégal. C'est la première fois depuis longtemps que Mme Noriko Furuya revient au Sénégal et cette fois, dans le cadre des activités de l'association « Lavons-nous les mains », elle a apporté un livre d'images intitulé « Digante » écrit en japonais, en français et en wolof pour les enfants sénégalais, créé par sa petite-fille, Midori. En tant que Japonaise, il semble naturel que les enfants reçoivent un enseignement scolaire dans leur langue maternelle, le japonais, mais au Sénégal, des discussions sont en cours sur la manière d'utiliser le wolof et le français, les langues de nombreux Sénégalais, dans l'enseignement scolaire. Mme Noriko Furuya pense que l'éducation dans la langue maternelle est importante, et elle a créé ce livre d'images avec Midori-san.
À propos de langue, Mirei Tomoyama, étudiante en troisième année à l'université de Keio, s'est récemment rendue au Sénégal. Elle pense que les enfants sénégalais doivent comprendre le français pour recevoir une bonne éducation et travaille sur une application permettant aux enfants d'apprendre le français à partir du wolof. Je suis vraiment impressionné par le fait qu'une jeune étudiante se lance encore dans ce genre d'entreprise. Tout en repensant à mes propres années d'études dans un passé lointain, lorsque je m'amusais, j'encourage les jeunes du Japon d'aujourd'hui, en pensant qu'ils s'en sortent plutôt bien.
Enfin, au début du mois de septembre, Sachiko Nakajima, l'un des producteurs de l'exposition d'Osaka de l'année prochaine et leader du « Kurage Band », est venu au Sénégal avec le groupe et une équipe de tournage de Yomiuri TV. Ils se sont rendus sur place pour filmer des séquences qui seront présentées au « pavillon des méduses » de l'exposition. Le tournage a eu lieu sur l'île de Gorée, dans la ville de Dakar et à Nbour, en particulier sur l'île de Gorée, où le Kurage Band s'est produit avec la famille Ndiaye Rose. La pianiste Mme Nakajima a joué avec plaisir le piano, qui a été donné lors du festival de musique de paix de l'île de Gorée en juin et qui est maintenant entreposé dans le centre culturel de la ville de Gorée. Au cours de la visite et de la représentation, Mme Nakajima a été ravie d'être submergée par l'atmosphère sénégalaise. Le thème du pavillon des méduses est « Améliorer la vie ». Nous attendons avec impatience de voir quelles images du Sénégal seront présentées à l'Expo l'année prochaine.
2 Contribution – KIMIJIMA Takashi, Expert de la JICA dans le domaine de l’agriculture, Président et Directeur Représentant de RECS International Inc.
1. Introduction
Je suis consultant en développement et j'ai 40 ans d'expérience dans le domaine de l'aide publique au développement (APD), y compris la recherche, la planification et le transfert de technologie liés au développement agricole et rural et au développement régional dans les pays en développement du monde entier. Au cours des 20 dernières années, je me suis spécialisé dans la coopération technique pour la promotion de la production de riz en Afrique, en me concentrant sur deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Sierra Leone. Dans cet article, je vous raconterai l'histoire de mon travail et de la riziculture au Sénégal, domaine dans lequel j'ai une longue expérience.
2. L'étude du schéma directeur et le riz qui m'ont amené à intervenir au Sénégal
Ma relation avec le Sénégal a commencé en 2004, il y a 20 ans. J'ai été approché par un consultant qui était un étudiant senior et qui participait à un projet d'enquête de la JICA. L'objectif de l'enquête était d'identifier la situation actuelle et les défis du secteur du riz et de préparer un plan directeur pour le développement du secteur au cours des 10 prochaines années. L'étude a duré environ deux ans et a impliqué huit experts japonais, y compris moi-même et j'étais chargé de la technologie de la riziculture et des aspects socio-économiques.
À l'époque, le secteur rizicole sénégalais était en pleine tourmente suite à la politique d'ajustement structurel de la Banque mondiale, qui comprenait la dévaluation de la monnaie en 1994 et le démantèlement des entreprises d'État qui soutenaient tout, de la production à la transformation et à la distribution. Le prix des machines et des engrais importés a doublé à la suite de la dévaluation de la monnaie, ce qui a entraîné une hausse considérable des coûts de production. Parallèlement, le démantèlement des entreprises d'État a coupé les canaux de distribution, laissant les producteurs sans endroit où vendre leur riz, même s'ils le produisent. En particulier, pour les organisations paysannes qui vivaient de la culture du riz dans le bassin du fleuve Sénégal, où des installations d'irrigation avaient été développées, l'impossibilité de vendre le riz qu'elles produisaient était une question de vitale. On dit que ce projet de recherche a été créé par le chef du bureau de la JICA au Sénégal de l'époque, qui a entendu les voix sérieuses des riziculteurs sur le terrain : « Nous voulons que vous puissiez vendre le riz que vous produisez ».
3. L'impact du schéma directeur et la contribution du Japon à la filière rizicole sénégalaise
suite à l'étude du plan directeur
Il est apparu clairement que la question la plus importante pour rendre le riz sénégalais vendable, ainsi que pour sécuriser les canaux de distribution était d'améliorer la qualité du riz usiné afin de répondre aux préférences des consommateurs. Les consommateurs urbains de Dakar et d'ailleurs évitent le riz produit localement, de couleur terne et contaminé par des impuretés, y compris des cailloux, au profit du riz importé. Ce n'est qu'en améliorant la qualité de l'usinage que les riziculteurs pourront produire du riz en toute sérénité. Le plan a défini les priorités et l'orientation du développement futur de la riziculture. Par la suite, sur la base des résultats de ce plan directeur, la JICA a mis en œuvre une coopération technique visant à améliorer la productivité du riz dans les zones irriguées du nord du bassin du fleuve Sénégal, qui dispose d'un potentiel de production élevé, et a introduit des machines japonaises d'usinage et de triage du riz auprès des riziculteurs, ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité d'usinage du riz produit dans le pays. En conséquence, le riz produit dans le bassin du fleuve Sénégal (riz produit localement) est maintenant disponible pour la première fois dans les supermarchés de la capitale Dakar.
Il s'agit d'une contribution très importante du Japon à la réalisation du plan d'autosuffisance en riz, qui est également la politique nationale du Sénégal. Les agriculteurs sont maintenant en mesure de se concentrer sur la production, car ils se rendent compte que le riz produit localement se vend bien.
4. La diversité de la riziculture au Sénégal
D'autre part, cette étude a révélé que l'environnement de la production rizicole au Sénégal varie considérablement d'une région à l'autre en termes de conditions naturelles, de contexte socioculturel et de riziculteurs. Certains de ces éléments sont présentés ci-dessous.
Les zones de production rizicole se répartissent principalement entre le bassin du fleuve Sénégal au nord, le bassin du fleuve Sine Saloum au centre, le bassin du fleuve Gambie au sud-est et la région de Casamance au sud.
Le bassin du fleuve Sénégal est proche de la limite méridionale du désert du Sahara, avec des précipitations de l'ordre de 200-400 mm/an, et l'agriculture est principalement pratiquée dans un environnement hydrique contrôlé, avec des installations d'irrigation construites le long du fleuve Sénégal avec l'aide de donateurs. La région dispose d'une distribution de sols argileux propices à la croissance du riz et d'un rayonnement solaire très élevé, ce qui permet une riziculture très productive avec des intrants importants. L'histoire de la riziculture est relativement récente et la culture du riz est pratiquée principalement par les Wolofs dans le cours inférieur du fleuve, mais au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les terres, la plupart des habitants sont des Peuls, qui étaient à l'origine des nomades.
Dans le bassin du fleuve Sine Saloum, dans la partie centrale, et dans le bassin du fleuve Gambie, dans le sud-est, l'agriculture est essentiellement pratiquée dans les champs. En raison des faibles précipitations, l'aliment de base est principalement le mil et le maïs produits par les hommes. La culture du riz, qui est pratiquée à petite échelle dans des zones de plaine limitées, est principalement destinée à la subsistance, les femmes étant chargées de tout, du labour à la récolte et à la manutention post-récolte. Les femmes, dont le statut religieux et socioculturel est inférieur à celui des hommes, ont un accès limité à l'information et à la technologie, ont hérité des méthodes agricoles traditionnelles de leurs parents et effectuent presque tous les travaux agricoles à la main. Elles s'occupent également des tâches ménagères et des enfants, et travaillent sans dormir. La culture du riz aurait été introduite par des migrants venus de la Gambie voisine, au sud, ou de la Casamance, plus au sud.
En revanche, dans le sud de la région de Casamance, les méthodes de culture du riz diffèrent selon l'ethnie qui habite la région, et à Ziguinchor, qui serait la plus ancienne zone de culture du riz, la culture du riz par les Jolas est solidement établie. Le labour est effectué par les hommes à l'aide d'une houe spéciale à long manche, appelée kajandu, qui a la forme d'une rame de bateau. Les femmes créent ensuite une pépinière, cultivent les jeunes plants et les transplantent dans les zones labourées et billonnées par les hommes. Les mauvaises herbes poussent rarement dans cette région et le désherbage est donc rare. La récolte se fait en coupant la base de l'épi à l'aide d'un couteau, en regroupant les épis coupés et en les portant sur la tête. Pour eux, le riz est utilisé comme une offrande sacrée, pour les mariages et les funérailles, ce qui explique probablement pourquoi certaines régions n'utilisent toujours pas de produits chimiques ou de machines pour la culture du riz. Ils disent également que lorsque le chef de famille meurt, sa grandeur est indiquée par la quantité de riz stockée dans la maison. En outre, on raconte qu'il existe une réserve constante de riz pour aider ceux qui ont besoin de nourriture.
Il existe donc une grande variété de cultures de riz au Sénégal !
5. Ma méthode de transfert de technologie
Depuis l'étude du plan directeur susmentionné, j'ai eu la chance de participer à quatre projets de coopération technique au Sénégal liés à la promotion du riz, en travaillant avec des agriculteurs et leurs agents de vulgarisation dans le nord, le centre et le sud-est du pays pour développer et diffuser des technologies permettant d'améliorer la productivité du riz dans le passé, j'ai travaillé avec des agriculteurs et leurs agents de vulgarisation pour développer et diffuser des technologies visant à améliorer la productivité du riz. Le développement d'une technologie n'est pas une tâche difficile, mais plutôt une application opportune de la technologie en fonction de la saison de croissance de la plante de riz afin de rendre les pratiques agricoles des agriculteurs plus efficaces et efficientes.
Bien que j'en sache plus qu'eux sur le riz, les agriculteurs locaux maitrisent bien l'environnement local, comme le climat et la nature du sol. Même si, à première vue, cela peut sembler inapproprié, il y a une certaine rationalité dans leurs pratiques agricoles, et si nous imposons seulement notre théorie sans la comprendre, elle ne sera pas acceptée et échouera. Il faut d'abord connaître la riziculture qu'ils pratiquent et l'environnement de la riziculture, puis trier les problèmes, réfléchir à différentes approches pour les résoudre et les expliquer aux agriculteurs par un processus d'essais et d'erreurs. Il faut parfois du temps pour obtenir des résultats, mais nous procédons ainsi parce que nous pensons qu'il s'agit de la méthode la plus fiable. Ce processus permet également d'instaurer un climat de confiance avec les agriculteurs.
6. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui se passera à l'avenir ?
Les projets de coopération technique auxquels nous avons participé dans le nord et le centre du pays ont confirmé l'efficacité des technologies recommandées que nous avons développées, et les riziculteurs auxquels ces technologies ont été transférées ont considérablement augmenté leur productivité.
Actuellement, dans le sud-est, nous relevons le défi d'améliorer la productivité du riz pluvial dans des environnements divers, où l'environnement naturel et les riziculteurs sont différents. Une liste de mots-clés pour les défis révèle qu'ils sont nombreux : la bonne variété, la culture du riz pluvial, la gestion des mauvaises herbes, les herbicides, la bonne quantité de semis, la gestion de l'eau, la conservation des sols, les machines agricoles appropriées, le genre, etc. Chacun de ces problèmes n'est pas facile à résoudre, mais nous parcourons avec eux les parcelles de riz des agriculteurs coopérants et des groupes d'agriculteurs, nous observons la croissance du riz et nous échangeons avec eux des points de vue sur les pratiques et les techniques agricoles que nous avons essayées.
À l'avenir, parallèlement à notre travail actuel dans le sud-est, nous prévoyons également de soutenir la riziculture dans le sud de la région de Casamance, qui est considérée comme la plus ancienne région rizicole du Sénégal. Après avoir commencé par la riziculture irriguée dans le nord, nous avons finalement atteint, après 20 ans, la riziculture pluviale dans le sud, la terre sacrée du riz sénégalais.
Dans le cadre de mon travail, j’ai côtoyé la vie et la culture des sénégalais et j'ai été touché par leur gentillesse, leur gaieté et leur générosité. Un ami sénégalais m'a dit un jour : « You Island, vieillir n'est pas une question d'âge, mais d'état d'esprit », et cela m'est apparu clairement vrai. J'ai maintenant l'âge de prendre ma retraite à tout moment, mais je veux garder l'esprit jeune et continuer à faire ce que je peux pour le Sénégal un peu plus longtemps.
3 Avis de Recrutement
L’Ambassade du Japon au Sénégal cherche un Secrétaire (à temps plein)pour sa Section Protocole, Affaires Politiques et Générales.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/files/100713433.pdf
4 Activités et annonces de l’Ambassade du Japon
○Réunion ministérielle sur la TICAD 9
La réunion ministérielle sur la TICAD 9 s’est tenue les 24 et 25 août à Tokyo. S.E. Mme Yacine FALL, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal y a pris part.
https://www.mofa.go.jp/af/af1/pagewe_000001_00054.html
https://x.com/MiaaeSenegal/status/1827749666622156927
○Visite de courtoisie auprès de S.E.Mme. DIOUF, Ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires
Le 29 août, l'Ambassadeur Izawa a rendu une visite de courtoisie au ministre des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, Mme. Fatou DIOUF, et a échangé des points de vue sur la coopération économique dans le secteur de la pêche.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01512.html
○Visite de courtoisie auprès de S.E.M. DIOP, Ministre de l'Industrie et du Commerce
Le 29 août, l'Ambassadeur Izawa a rendu visite au Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. DIOP, et ils ont échangé sur les stratégies de l'industrialisation du Sénégal ainsi que sur la participation du Sénégal à l'Expo 2025 prévue l'année prochaine.
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01510.html
○Réception avec l’équipe de l’Université Koto Seïka
Le 26 août, l’Ambassadeur Izawa a accueilli l’équipe de l’université Kyoto Seïka à sa résidence, et discuté sur l’échange interuniversitaire entre le Japon et le Sénégal.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LAXGca8kcuVkx3GMPTe1aKJd5M4Hn94uU6kTRvxiMWbdK1zZiG8DvgQMzwiTP584l&id=100078921276471
----------------------------------------------------------------------
○Liens de l’Ambassade du Japon
Site web( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
Twitter ( https://twitter.com/JapanEmbSenegal )
Facebook ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471 )
Instagram ( https://www.instagram.com/japanembsenegal/ )
○Publication:Ambassade du Japon au Sénégal
Ambassade du Japon au Sénégal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Sénégal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55